 |
| Rivista di Massoneria - Revue de Franc-Maçonnerie - Revista de Masonerìa - Revista de Maçonaria |
|---|
| History Literature Music Art Architecture Documents Rituals Symbolism |

|
 |
| Rivista di Massoneria - Revue de Franc-Maçonnerie - Revista de Masonerìa - Revista de Maçonaria |
|---|
| History Literature Music Art Architecture Documents Rituals Symbolism |

|
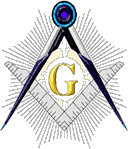
ÉTUDES MAÇONNIQUESL’ouverture d’un horizon académiqueAcadémiciens et francs-maçons messins au XVIIIe sièclepar Pierre-Yves Beaurepaire |
|
A partir du milieu du XVIIIe siècle, le « creuset
messin »[1],
frontière riche de brassages de populations, de contacts et d’échanges
culturels, est marqué par un rapide développement de la sociabilité nouvelle
et de ses instances. Les loges maçonniques locales, désormais solidement établies,
tissent leurs réseaux de correspondance à travers toute l’Europe et reçoivent
les visites de frères de marque, allemands, scandinaves ou russes. Elles s’imposent
ainsi comme de puissants intermédiaires culturels. Des syncrétismes s’ébauchent,
quelques-unes des plus riches pages de l’histoire de la Franc-maçonnerie des
hauts grades s’écrivent ici. Au point que, comparativement, la sociabilité
académique semble faire pâle figure à Metz, et ne pas profiter de cette
situation privilégiée de carrefour.
La Société d’Etudes des Sciences et des Arts fondée le
22 avril 1757, devenue Société Royale des Sciences et des Arts par
lettres patentes de juillet 1760, est en effet généralement considérée comme
un foyer culturel enclavé, qui peine à dépasser l’horizon provincial et à
renouveler ses effectifs. Pour un peu, l’Académie messine apporterait la
contradiction à la thèse largement admise selon laquelle l’innovation
viendrait des marges. Pour D. Roche, qui suit J.-C. Le Breton, elle tourne le
dos à l’Allemagne, alors que les abbayes bénédictines avaient tissé un
dense réseau d’échanges culturels avec l’étranger proche[2].
La Société Royale des Sciences et des Arts se rapproche paradoxalement
plus de l’Académie de Pau bloquée autant par son conservatisme que par la
barrière pyrénéenne, que de celle de Dijon, société extravertie prompte à
tirer partie de la situation de carrefour sur les routes du Grand Tour qu’occupe
la cité bourguignonne.
Pourtant, les indices d’une ouverture à l’Autre peuvent être mis en
évidence. Ouverture aux problèmes extra-provinciaux, aux sujets philosophiques
et littéraires initialement exclus des préoccupations des Académiciens
messins ; ouverture sur les Républicains des lettres et leurs réseaux de
correspondances. Pour comprendre ce désenclavement d’un groupe académique,
porter le regard sur une société littéraire en marge de la reconnaissance
académique -la Société des Philathènes- ainsi que sur les loges maçonniques
messines, leur ambitieux projet d’un réseau de correspondance européen, leur
rôle d’actif trait d’union entre les Fraternités française et allemande
offre plusieurs pistes. L’importance du phénomène de double appartenance
-loge/Académie- voire de triple appartenance -loge/Académie/Société des
Philathènes a été sous-estimé par J.-C. Lebreton puis
par D. Roche en raison de l’utilisation exclusive de source postérieures
à la reprises en main de la Franc-maçonnerie provinciale par le Grand Orient
en 1773-1774 qui occultent trente ans d’activité maçonnique intense à l’échelle
européenne[3].
En outre, la plupart des dirigeants maçonniques locaux, qui furent à
l’origine de l’aventure européenne des loges maçonniques, furent des
chevilles ouvrières de l’Académie et d’incontestables artisans de son
ouverture.
Autrement dit, le cas messin, plutôt que de s’inscrire dans l’opposition
simpliste entre une sociabilité traditionnelle, recroquevillée sur elle-même,
en perte de vitesse, et une sociabilité nouvelle, qui transcenderait les barrières
sociales, géographiques et culturelles, montre comment les différentes
instances de la sociabilité des Lumières peuvent se stimuler, s’ouvrir à de
nouveaux horizons, et se compléter -les francs-maçons messins trouvant dans la
Société des Philathènes, comme c’est le cas ailleurs dans les Musées, une
réponse à leur « tentation académique ».
Dès l’origine, la Société
Royale des Sciences et des Arts cherche à reproduire fidèlement dans le champ
de la sociabilité la hiérarchie provinciale et à s’imposer comme le cénacle
où s’épanouissent les élites messines. Sa devise est « Utilité
publique », mais « Conformisme et conservatisme social »
pourrait en tenir lieu. La composition de la classe des « membres nés »
signale d’entrée l’esprit qui préside au recrutement des académiciens
messins : l’évêque, le commandant militaire de la province, le premier président
du parlement, l’intendant...[4],
assurent la réputation et la direction morale de la Société Royale. La
composition des « honoraires » traduit également la fermeture du
groupe académique : plus de 90% sont nobles. Inversement, au fur et à mesure
que l’on descend dans la hiérarchie académique, les représentants du tiers
état sont plus présents. Absents des membres nés et des honoraires, ils
fournissent le tiers des titulaires, et représentent 47% des associés libres
et 57% des correspondants. Cette distribution inégale entre les classes fournit
clairement la réponse de l’Académie messine aux questions qui taraudent
alors l’ensemble des académiciens des lettres : l’égalité doit-elle régner
au sein du corps académique ? Jusqu’où les académiciens se considèrent-ils
comme des pairs ? Quelle place accorder au statut social de chacun ? La
composition de la classe des « titulaires » en fournit une éclatante
confirmation. Les deux ordres privilégiés fournissent les deux tiers du groupe,
tandis que la bourgeoisie à talent se partage l’essentiel du reliquat, avec
deux composantes principales : les avocats et les médecins. Apothicaires, négociants
et représentants des métiers sont absents de la Société. Et lorsque l’apothicaire
de l’hôpital militaire, Thyrion, confiné dans la classe des associés libres,
demande à être reçu titulaire en 1764 puis en 1771, c’est une véritable
lever de bouclier. Les difficultés économiques des négociants
messins ont sans doute joué en leur défaveur, mais leur absence résulte
surtout de l’application par l’Académie de la fameuse loi d’exclusion réciproque
de l’otium et du nég/otium [5].
Cette fermeture du groupe académique messin le distingue ainsi de celui
de Dijon, pourtant lui aussi fortement marqué par l’empreinte parlementaire,
et tranche singulièrement sur l’équilibre harmonieux entre les ordres
maintenu par Séguier et les siens à Nîmes [6].
Le conformisme et le conservatisme social ont indiscutablement sclérosé la
Société d’Etudes, puis à partir de 1760 la Société Royale des Sciences et
des Arts. Les effectifs se renouvellent très difficilement avec comme
corollaire le vieillissement continu de la société et la vacance de plusieurs
sièges d’honoraires et jusqu’à sept places de titulaires. De 1761 à 1793,
la Société pose en moyenne moins d’un sujet par an, indice d’une activité
médiocre. Surtout, en plus de trente ans d’existence, on ne constate aucune
évolution sensible du recrutement sur le plan social : l’Académie messine
demeure un cénacle tourné vers les ordres privilégiés et semble ignorer les
demandes en provenance des catégories montantes du tiers état, notamment des
robins et des négociants qui chercheront ailleurs leurs foyers de sociabilité
d’élection. La position sociale
des impétrants dicte strictement les choix de la Société Royale, d’où un
manque de souplesse évident. Les promotions académiques sanctionnent les
promotions sociales. Le cas de Claude-François Bertrand de Boucheporn, académicien
et franc-maçon, seul titulaire à accéder à la classe des honoraires, est
riche d’enseignement. Fils d’un conseiller au parlement, il devient
titulaire alors qu’il est avocat général au parlement ; nommé intendant de
Corse il devient honoraire. La Société Royale fait preuve de frilosité, de
manque d’initiative. Elle attend pour agréger tel postulant qu’il ait concrétisé
les potentialités qu’il recèle, alors que plusieurs de ses consoeurs
choisissent de reconnaître des talents précoces et d’offrir ainsi une plus
large audience à leurs travaux. François de Neufchâteau est membre des Académies
de Dijon, Lyon, Marseille et Nancy dès les années 1760, soit plus de vingt ans
avant son admission à Metz.
La Société Royale fait également de l’enracinement dans la province
une véritable profession de foi. Elle ne manque pas de faire part de sa
mauvaise humeur lorsque les mémoires
qui lui parviennent suggèrent que les problèmes économiques et sociaux du
temps ne doivent pas être appréhendés dans une perspective strictement
locale, nécessairement réductrice, mais à une toute autre échelle : «
[Elle] se croit donc obligée de rappeler que lorsqu’une Académie offre à
traiter une question relative à sa province, bien loin de généraliser les idées,
les sujets et les moyens, il faut au contraire les restreindre et les adapter précisément
au local » [7].
La place accordée dans la classe des titulaires à deux groupes, les officiers
du parlement qui représentent plus
de 20% des effectifs, toutes classes confondues, et le clergé régulier témoigne
de cet enracinement local et provincial. La forte présence parlementaire
rapproche Metz des Académies de Bordeaux et de Dijon[8],
tandis que la Société d’Etudes reconnaît et consacre dans ses premiers
statuts, le rôle éminent des
chanoines réguliers et des Bénédictins des quatre abbayes messines dans les
dispositifs culturels messins et lorrains en leur accordant de droit des représentants
en son sein. A l’inverse, la noblesse militaire -avec 7% des titulaires- est
sous-représentée par rapport à la part de la garnison dans la société
messine. C’est le signe concordant du désir des Académiciens
de ne choisir comme pairs
que des Messins enracinés dans la province : les officiers militaires ne sont
que de passage à Metz, leur commerce avec la société locale n’est souvent
que superficiel. Par ailleurs, les préoccupations des militaires : trouver un
foyer de sociabilité chaleureux, qui atténue le déracinement lié aux
affectations successives, les orientent d’eux-mêmes davantage vers les loges
maçonniques.
Les sujets proposés aux concours et les travaux ordinaires traduisent
aussi à leur manière l’étroitesse de l’horizon et du projet académiques.
On est loin de la curiosité universelle des Vannistes. Les Belles-Lettres et le
droit sont négligés, les récits de voyage intéressent peu les académiciens
qui contestent même l’utilité du Tour de formation. Le groupe académique
est d’abord composé de propriétaires fonciers, dont les préoccupations sont
clairement utilitaires et locales. La Société Royale qui fait fonction de société
d’agriculture ne veut pas couronner des mémoires théoriques, mais multiplier
les expériences et les enquêtes locales, et mettre sur pied un réseau d’informateurs
parmi les « cultivateurs éclairés ». Les Académiciens messins
qui, par la suite, bénéficieront d’une solide réputation agronomique,
interdisent quasiment, par la formulation de leurs sujets, toute contribution étrangère
à la province : ainsi Les
productions les mieux adaptées au pays messin ou encore les Moyens de
supprimer la jachère -pourtant d’une criante actualité sur le fond- n’obtiennent
pas de réponse. La distribution géographique des lauréats successifs est
parlante : La domination messine et plus largement lorraine est écrasante.
Jusqu’en 1789, on enregistre un seul lauréat issu des principautés ecclésiastiques
allemandes : le négociant Lagrange, demeurant à Coblence. Mais il s’agit en
fait d’un Messin, fait significatif. Elle élargit certes son horizon aux
provinces environnantes : Lorraine ducale, électorat de Trèves, duché de
Luxembourg, mais l’ouverture en direction des sociétés françaises, et
surtout allemandes et suisses en plein essor est différée.
En fait, les académiciens messins ont manifestement du mal à trouver
leurs marques dans un espace
lorrain en mutation, et plus encore dans une Europe où les échanges économiques,
culturels et humains s’accroissent et se réorientent rapidement. Leur goût
pour l’histoire masque mal la nostalgie des temps glorieux dans laquelle ils
se réfugient. La foire de mai à Metz, ou encore Metz ville impériale,
ne rencontrent qu’un très faible écho ; l’Académie s’entête pourtant,
elle pose vainement à trois reprises fois un sujet sur les Moyens de rétablir
Commerce et industrie à Metz sans penser que ces échecs répétés
trahissent une absence d’audience qui reflète elle-même le décalage entre
ses préoccupations et celles des Lumières techniciennes dont elle cherche à
obtenir le concours. Plus grave encore, les quelques thèmes novateurs proposés
par l’actif Roederer, ainsi l’Influence du canal Meuse-Seine sur le
commerce des Evêchés, n’obtiennent pas davantage de réponse.
En cette fin de XVIIIe siècle, le conseiller au Parlement
Pierre-Louis Roederer tente en effet de réveiller ses confrères. Metz n’est
plus l’entrepôt majeur sur les voies de terre et d’eau qui unissent l’Europe
du Nord-Ouest à l’Europe médiane, les Provinces Unies à la Suisse. Les flux
commerciaux se sont décalés vers l’Est, au profit de Francfort-sur-le-Main.
Une révision, certes déchirante, s’impose donc : Metz n’est plus la
brillante capitale du royaume d’Austrasie, ni la riche ville libre impériale.
Le salut passe par une ouverture plus marquée en direction des Etats
germaniques, par un développement des échanges transversaux avec Francfort.
Pour Roederer, lui-même marié avec la fille d’un banquier francfortois et
associé en affaires avec des Strasbourgeois et des négociants de Francfort, il
revient à la Société Royale d’initier par ses contacts, et de stimuler par
ses concours cette reconversion des horizons messins, en proposant notamment
d’étudier les possibilités de meilleures liaisons fluviales, débarrassées
de leurs « obstacles politiques » et de leurs nombreux péages[9].
Une association étroite entre Metz et Francfort n’intéresse d’ailleurs
pas seulement l’économie. La ville libre impériale est en effet le théâtre
d’une riche vie culturelle fortement influencée par l’apport français
depuis l’ambassade du Maréchal de Belle-Ile -futur protecteur de l’Académie
messine- près la Diète impériale lors de la crise de la succession d’Autriche.
L’édition y est active, et diffuse largement ses productions en France[10].
Pourtant les Académiciens messins n’ont pas su nouer avec Francfort les mêmes
relations que les Bénédictins et francs-maçons lorrains. Un fait illustre ce
potentiel inexploité : pour faire venir de Francfort à Metz les ouvrages qui
doivent enrichir leur bibliothèque, les Académiciens peinent souvent et
doivent recourir aux services du libraire et franc-maçon alsacien Saltzmann,
donc à un intermédiaire géographiquement plus éloigné de Francfort que
Metz, alors que les Bénédictins utilisent couramment leur important réseau de
correspondants dans l’Empire pour se procurer les ouvrages qu’ils convoitent.
Surtout le contraste est saisissant entre l’inexistence des relations académiques
entre Metz et Francfort, et la richesse d’échanges maçonniques initiés très
tôt par les Messins.
Les loges francfortoises, dont la célèbre loge Zur Einigkeit,
influencées par deux figures de proue de la Franc-maçonnerie européenne, le
marquis de La Tierce et Joseph Uriot, ont dès la décennie 1740 affiché leur désir
de donner corps au projet d’un cosmos maçonnique. Or, simultanément, un négociant
et franc-maçon messin, Antoine Meunier de Précourt, en affaires au profane
comme au maçonnique avec le Lyonnais Jean-Baptiste Willermoz, et membre
influent de la Grande Loge de France, conçoit l’idée d’un vaste réseau de
correspondance européen[11].
Il s’agit notamment d’échanger des informations sur les rituels qui se
multiplient et circulent de manière incontrôlée, puis d’amorcer une
harmonisation des pratiques maçonniques en Europe. Le réseau de Meunier de Précourt,
qui recouvre partiellement comme celui de Willermoz, un réseau de
correspondants commerciaux -dont par essence l’Académie ne disposait pas-
devient l’un des plus étoffés d’Europe : Metz est non seulement uni à
Francfort, Coblence, Mayence, et Hanovre, mais aussi à Alost dans les Pays-Bas
autrichiens, et même à une loge de Palerme qui bénéficie du savoir-faire
d’un consul des Cantons suisses pour mettre sur pied un solide réseau de
correspondances capable de l’intégrer à la Maçonnerie continentale. Surtout
les francs-maçons messins savent saisir toutes les opportunités qui s’offrent
à eux, d’étoffer leurs réseaux, de nouer de nouveaux contacts. Meunier de
Précourt convainc ainsi la loge de La Triple Union de Reims de mettre à
profit la position de carrefour de Reims sur les routes commerciales et du Grand
Tour, pour donner naissance à un réseau de correspondances capable de
renforcer la couverture de l’espace maçonnique européen amorcée par les
Messins. Le passage par Metz de nombreux francs-maçons étrangers en transit
est valorisé : tels ces militaires anglais venus négocier la libération des
derniers prisonniers de la guerre de Sept Ans, et chaleureusement accueillis en
loge [12].
Une promesse de commerce épistolaire est faite, gage d’un enrichissement
mutuel.
Si, à cette époque, la Société Royale des Sciences et des Arts de
Metz n’a pas encore de correspondant étranger, les premiers indices
concordants de son ouverture apparaissent peu après. Ouverture d’autant plus
singulière, qu’elle se produit sans que n’apparaissent de rupture, d’inflexion
sensibles dans la composition sociale du groupe académique. Par le choix de ses
associés libres et correspondants, l’Académie déborde désormais du cadre
strictement provincial, et commence à sortir de la relation exclusive avec le
centre parisien. Alors que durant ses premières années d’existence, le
groupe recherchait davantage des appuis auprès des autorités provinciales et
centrales que l’affiliation de représentants des Lumières techniciennes, une
évolution est désormais nettement perceptible. La Société accueille
Parmentier, qui lui adresse nombre de travaux, confirmant son orientation
agronomique. Elle s’agrège ainsi un correspondant de plusieurs académies.
Signe d’une honnête réputation, elle reçoit la visite d’A. Young. Avec
Vicq d’Azyr, secrétaire perpétuel de l’Académie royale de médecine, elle
prend connaissance des derniers progrès de la science médicale, que diffuse et
relaie sur place Michel du Tennetar, médecin des épidémies. Avec Perronet,
inspecteur général des Ponts-et-Chaussées, membre de l’Académie des
Sciences, des Académies de Berlin et de Stockholm, l’Académie prend mieux
conscience de la nécessité de développer les infrastructures de la province
en liaison avec les Etats voisins dans le cadre d’une véritable coopération
transfrontalière avant la lettre. Avec Pilâtre de Rozier, elle ne s’enthousiasme
pas seulement pour les aérostats, mais s’intéresse à une nouvelle instance
de la sociabilité littéraire et scientifique, plus souple, plus ouverte que
l’Académie, à savoir le Musée. Significativement, le projet de Musée
messin rédigé par Roederer sur la demande de ses pairs, s’inspirera du Musée
de Monsieur, œuvre de Pilâtre de Rozier.
Recevoir ces figures des Lumières techniciennes flatte l’orgueil du
groupe académique provincial, mais elles permettent surtout aux Messins de se
connecter avec des réseaux de rang européen. Des liens se renforcent, des
ouvertures de précisent, de nouvelles ramifications apparaissent dans des régions
du savoir et de l’espace européen auxquelles nos académiciens avaient jusque
là peu accès. Plus modestement, recevoir l’abbé Grandidier, à la tête
d’un réseau d’une centaine de correspondants, ou le chanoine Neller de Trèves,
c’est pour les Messins améliorer leur couverture de « l’étranger
proche », notamment des Electorats ecclésiastiques allemands.
Des contacts sont aussi noués avec Liège, Rome et surtout la Suisse,
dont la vigueur des sociétés économiques est incontestable. L’Ökonomische
Gesellschaft de Berne correspond avec toute l’Europe, diffuse largement
ses Traités et Observations en français et en allemand, ce qui fait
dire à Karl von Zinzendorf en 1764 que « la Société Economique de Berne
est la mère de toutes les organisations du même ordre qui ont pu être créées
par la suite en France, en Angleterre, en Allemagne, et même en Suisse »[13].
Si Zinzendorf oublie que la société de Brest a servi de modèle à celle de
Berne, son témoignage n’en révèle pas moins la forte impression que les
sociétés économiques suisses laissent à leurs visiteurs. Or, cette fois la
Société Royale met à profit les liens anciens qui unissent Metz aux Cantons
pour entrer en contacts avec ces sociétés. Cette ouverture est le fruit
d’une initiative individuelle, trait caractéristique de la sociabilité des
Lumières. Le baron Jean-Baptiste-Théodore de Tschoudy, bailli royal, membre de
la branche cadette d’une vieille famille de la noblesse suisse au service de
France, prend à partir des années 1760 une part importante dans la direction
de la Société. Il se passionne pour l’agriculture et pour les idées
physiocratiques. Sous son impulsion et celle de quelques autres de ses confrères,
la Société qui a déjà reçu le
marquis de Mirabeau en 1760 et rendu compte de ses ouvrages, s’intéresse d’abord
aux expériences faites en France et à l’étranger : prairies artificielles
des Flandres et de Bavière, innovations faites dans les colonies anglaises d’Amérique.
Tschoudy qui est membre des sociétés de Berne, Soleure et Zürich, amorce des
échanges épistolaires, et recommande à ses confrères messins les
candidatures de Hirzel, président de la Société Physique et Economique
de Zürich, et de Hermann secrétaire de la Société Economique de Soleure
comme correspondants. En direction des principautés germaniques, une ouverture
est tentée grâce à la réception du chanoine Neller de Saint-Siméon de Trèves
et du chargé d’affaires François Barbé, mais elle demeure modeste. Des
liens avec Cassel, plaque tournante des échanges culturels et maçonniques
franco-germaniques s’esquissent.
Des faiblesses structurelles demeurent cependant : le tropisme germanique
de la Société Royale est peu marqué ; elle semble avoir trop peu profité des
réseaux vannistes[14].
Faut-il y voir la conséquence des tensions survenues dans les années 1758-1760
au sein de la Société d’Etudes et qui ont entraîné le départ d’un
nombre significatif de réguliers ? Certaines offres de correspondances sont déclinées
ou reçoivent des réponses évasives, ainsi la proposition de Dubois de Fosseux,
le célèbre secrétaire arrageois. Cependant, l’ouverture est incontestable
et l’appartenance d’une majorité de Messins à plusieurs autres académies
renforce la dimension nationale voire européenne de leur engagement, et permet
à l’ensemble du groupe de mieux appréhender l’espace culturel européen et
la place que l’Académie provinciale peut y occuper.
Le désenclavement survient surtout lorsque la Société Royale se débarrasse
de sa frilosité initiale pour poser au concours des sujets hardis, en prise sur
les grandes questions philosophiques et
juridiques du temps. Le fameux concours sur les Juifs remporté par l’abbé Grégoire,
ne doit pas faire oublier les autres thèmes qui tous rencontrent un réel succès.
Le sujet de 1783 demande si les familles des criminels doivent supporter les
conséquences de crimes qu’elles n’ont pas commis -écho au
Traité des délits et des peines de Beccaria qui évoque le sujet,
et au débat soulevé par les affaires Calas et Sirven en leur temps. 22 mémoires
sont adressés à l’Académie, les vainqueurs sont deux avocats, Lacretelle,
futur membre de l’Académie française, de Paris, et Robespierre d’Arras. La
Société Royal récidive en 1786 avec un sujet sur la conservation des bâtards,
contribution au débat sur les enfants trouvés qui agite alors l’opinion éclairée[15].
L’année suivante est posé le sujet sur les moyens de rendre les Juifs plus
heureux, puis en 1790 la Société Royale interroge les Républicains des
lettres sur les moyens d’assurer le patriotisme dans le tiers état : c’est
un professeur de philosophie de Berlin, Villaume qui l’emporte. Déjà,
lorsque l’abbé Grégoire avait été couronné, il avait partagé ses
lauriers avec un Juif polonais, travaillant à la Bibliothèque Royale de Paris,
Hourvitz. Alors que jusqu’en 1781 les sujets de la Société Royale intéressaient
essentiellement des auteurs de Metz et des
environs, l’Académie reçoit désormais des mémoires de toute la France, de
Paris, de Champagne, de Besançon, de Rouen, mais aussi de Turin, de Stuttgart
et de Berlin à deux reprises.
La Société a enfin acquis une audience nationale et gagné l’écoute
des provinces de l’étranger proche, avant d’intéresser plus largement
l’ensemble de l’Europe éclairée. Deux lauréats, le Parisien Lacretelle et
le Berlinois Villaume l’ont parfaitement compris. Le premier souligne que le
sujet « très philosophique par les idées morales et politiques qu’il
embrasse, est encore tout national par l’heureuse réforme dans nos idées
et dans nos mœurs que sa discussion peut amener » ; tandis que le second
inscrit le sujet proposé par les Messins sur le tiers état dans le cadre du
formidable espoir né de 1789 : « Si vous saviez -écrit-il à la Société
Royale- avec quelle attente inquiète l’Europe attarde les yeux sur vous...
Vous avez entre vos mains, non pas votre propre cause seulement, mais celle de
l’humanité entière. C’est de vous qu’on attend la décision de la plus
grande question, qui fut jamais agitée, savoir, si l’égalité, la liberté,
la justice, les droits de l’humanité, sont autres choses que des chimères,
qu’une vaine théorie, impossible à réaliser ».
Certes, lorsqu’elle soumet ces sujets audacieux à la réflexion de ses
contemporains, la Société Royale s’attire les foudres de son protecteur, le
duc de Broglie à partir de 1771, mais elle persiste, ce qui révèle un
changement d’attitude de sa part. En outre s’affronter aux représentants de
la monarchie est à présent devenu le meilleur moyen de se faire valoir auprès
de l’opinion éclairée et des républicains des lettres. Mais l’audience
d’une Académie, l’écho de ses sujets, ne s’évaluent pas seulement
à partir du nombre de mémoires reçus, à partir des compte rendus des
journaux. Mettant l’accent sur des thèmes sensibles, les sujets messins
suscitent en retour des échanges épistolaires qui sont autant de traces
d’une ouverture réussie. L’Académie qui n’avait jusqu’ici pas de réels
contacts avec les provinces méridionales du royaume reçoit ainsi à l’occasion
des concours sur les juifs et les bâtards des lettres d’Aix, Toulouse,
Bordeaux, de Saint-Domingue... La lettre reçue permet ensuite, lorsqu’elle débouche
sur une correspondance régulière, d’étoffer le réseau messin. Ainsi La
Société Royale agrée en 1786 la demande du Cercle des Philadelphes du
Cap Français d’entrer dans son cercle de correspondances[16].
Expliquer cette ouverture aussi rapide que surprenante est somme toute
malaisé. Il semble cependant qu’au sein du champ de la sociabilité messine,
la Société des Philathènes[17]
et les loges maçonniques ont servi d’aiguillon pour le groupe académique, et
lui ont permis de renouveler son approche de la sociabilité éclairée et de
ses réseaux. La Société des Philathènes, plus ouverte socialement que l’Académie,
profite des initiatives culturelles, scientifiques et philosophiques des robins.
Formant 9% des membres de la Société Royale, ils représentent 48% des Philathènes.
A leur tête, Jean-Claude Emmery, futur chef de file du parti patriote à Metz.
Le programme des Philathènes est nettement plus ouvert que celui des Académiciens.
Les sujets philosophiques que les académiciens hésitent à évoquer, les
Philathènes s’y consacrent avec ardeur -les membres sont tenus de fournir des
travaux. De L’Esprit d’Helvétius,
Le Contrat Social de Rousseau sont étudiés de près. D’ailleurs,
lorsque D. Mornet vit dans l’Académie messine un foyer de l’esprit avancé,
il s’appuyait en fait sans le savoir sur les archives des Philathènes. L’horizon
de la Société déborde largement celui de la province : quand les Philathènes
étudient l’histoire ancienne, les trois-quarts de leurs travaux évoquent
l’Egypte, non l’archéologie locale. Si la Société royale s’interdisait
toute excursion exotique, les Philathènes s’intéressent à la civilisation
de l’Empire du Milieu. Or un quart sont d’actifs académiciens dynamiques,
parmi eux le baron Jean-Baptiste Tschoudy.
Leur société, en marge de la reconnaissance académique, a en outre répondu
à la « tentation académique » que ressentent alors nombre de
francs-maçons français, qui de par leurs qualités sociales peuvent
difficilement prétendre à un siège au sein d’une Académie[18].
Le projet des Philathènes de Metz est ainsi singulièrement proche de celui des
Philalèthes de Lille[19].
Les loges maçonniques ont quant à elles recruté dans les mêmes
milieux que l’Académie. Les parlementaires forment dès l’origine la
colonne vertébrale des loges avec notamment quatre des cinq Vénérables
successifs de la Loge ancienne de Metz. Parmi eux Théodore-Henri de
Tschoudy, cousin de l’académicien, figure de proue de la Franc-maçonnerie
européenne : maître de loge à Naples, en Hollande à Saint-Pétersbourg.
Esprit cosmopolite, ses ouvrages maçonniques et polémiques lui valent la
reconnaissance des siens ; intermédiaire culturel, il diffuse la pensée de
Voltaire en Russie par le biais de son Caméléon littéraire. Passé à
la loge Saint-Jean de l’Amitié de Saint-Etienne, il y rencontre
plusieurs des figures de proue de l’Académie et des Philathènes :
Jean-Claude Emmery, secrétaire perpétuel des Philathènes ; Bertrand de
Boucheporn, le futur intendant de Corse ; son cousin Tschoudy de Colombey dont
on a souligné le rôle comme un intermédiaire avec les sociétés suisses ;
Daniel-Charles Le Payen, secrétaire perpétuel de l’Académie. Le cas du
comte de Tressan fondateur de l’Académie nancéenne et promoteur de la
Franc-maçonnerie en Lorraine ducale n’est donc pas isolé. Par contre, les
loges messines ont nettement moins recruté parmi les réguliers que d’autres
loges lorraines, notamment celles de Toul et Saint-Avold, où les bénédictins
sont présents en nombre.
Les dirigeants maçons, Tschoudy en tête, se sont refusés à élargir
excessivement l’accès au temple. Cependant, les ateliers sont ouverts à l’élite
négociante. Outre l’exemple de Meunier de Précourt, un cas est révélateur
: Mathis, lauréat de l’Académie, ne saurait être reçu par elle ; au sein
des Philathènes, il se présente comme « citoyen de Metz » ; mais
en loge il peut faire état de sa qualité profane : négociant.
Les loges maçonniques ont aussi accoutumé l’élite du groupe académique
à transcender la sphère provinciale. Elles sont certes, comme l’Académie,
soucieuses de s’enraciner dans les Trois Evêchés, comme l’atteste en 1765
la fondation d’une Mère Loge Provinciale. Mais très vite, sous l’impulsion
de Théodore-Henry de Tschoudy qui prend le relais de Meunier de Précourt, les
francs-maçons messins ont cultivé leur rôle d’intermédiaire, de trait
d’union privilégié entre les Maçonneries française et allemande[20].
En recevant en Lorraine les grades chevaleresques allemands, ils accroissent
leur audience auprès de leurs frères de l’intérieur du royaume qui en sont
friands ; en retour, ils propagent en Allemagne une Franc-maçonnerie d’inspiration
chrétienne, qui concurrence victorieusement les influences anglaises.
De leur côté, les loges messines ont été influencées par l’organisation
académique. Le tableau des membres de Saint-Jean pour 1788 compte deux
catégories de membres, les « associés libres » et les « associés
honoraires » qui sont les « correspondants » de la loge auprès
de ses soeurs françaises mais aussi hongroises ou antillaises[21].
La référence académique est manifeste, il est vrai que le secrétaire perpétuel
de l’Académie, Le Payen, est alors un important dignitaire de la loge.
Ce commerce fructueux avec les autres instances de la sociabilité
messine a donc favorisé le singulier désenclavement du groupe académique et
l’essor de ses réseaux. Cette ouverture n’est certes pas achevée lorsque
la radicalisation révolutionnaire l’interrompt en 1792-1793, mais elle nous
apprend qu’une situation géographique de contact ne suffit pas à faire
d’une académie provinciale un intermédiaire culturel-né. La volonté d’inscrire
un projet académique provincial dans une perspective plus vaste est bien l’essentiel.
[1]
François-Yves Le Moigne, Gérard Michaux, « Metz au siècle des Lumières,
in François-Yves Le Moigne (sous la direction de), Histoire de Metz,
Toulouse, Privat, collection Univers de la France et des pays francophones,
1986, p. 290. [2]
Daniel Roche, Le siècle des Lumières en province, Académies et académiciens
provinciaux, 1680-1789, Paris, 1978, éd. 1989, Editions de l’EHESS,
tome I, p. 311. Jean-Christophe Le Breton, La Société Royale des
Sciences et des Arts de Metz (1757-1793). Etude de sociologie culturelle,
thèse de 3e cycle, Faculté des lettres et sciences humaines,
Paris, sous la direction d’Alphonse Dupront, 1967. Pourtant dom Jean-François
notamment n’a pas ménagé ses efforts pour convaincre les membres de la
première Société d’Etudes de multiplier les ouvertures culturelles. Son
Discours sur les avantages des Académies, Sociétés d’études littéraires
de 1757 reprend significativement celui qu’il avait prononcé en 1752 lors
de sa réception au sein de la Société germano-bénédictine. [3]
Le dossier Metz de la collection Chapelle [Bibliothèque nationale, Cabinet
des manuscrits, Fonds maçonnique, FM1 111, volume VI] permet de
restituer la richesse de la vie maçonnique à Metz à l’époque de la Grande Loge. [4]
Ils sont suivis par le princier de la cathédrale, et le maître-échevin de
Metz. [5]Les
contradictions de l’académisme qui se veut consacré à l’utilité
publique, à l’amélioration de l’agriculture et à la restauration du
commerce éclatent également avec la place faite aux arts mécaniques et à
leurs agents : dès 1757, une classe spéciale d’agrégés avec six sièges
leur est théoriquement destinée, elle reste désespérément vide jusqu’en
1784. La Franc-maçonnerie n’échappe d’ailleurs pas davantage à ces
contradictions de la sociabilité d’Ancien Régime, si l’on songe à sa
répugnance à s’ouvrir aux représentants des métiers. [6]
Avec, parmi les Académiciens ordinaires, 21,4% de membres issus du clergé
; 36,4% de la noblesse et 42% des bourgeoisies. D’après Daniel Roche,
« Correspondance et voyage au XVIIIe siècle : le réseau
des sociabilités d’un académicien provincial, Séguier de Nîmes »
in Les Républicains des Lettres, Gens de culture et Lumières au XVIIIe
siècle, Paris, Fayard, 1988, p.268 [7]
Bibliothèque municipale de Metz, mss 1342, Etat de la Société royale au
mois d’août 1769, p.18. [8]
Elle la distingue des instances culturelles provençales par exemple,
auxquels les parlementaires aixois, pourtant eux aussi enracinés dans leur
province, participent peu, tant comme associés que comme
titulaires [Monique Cubells, La Provence des Lumières, Les
parlementaires d’Aix au XVIIIe siècle, Paris, Maloine,
1984, pp.351-352]. [9]Le
secrétaire perpétuel de l’Académie, Le Payen, propose quant à lui, de
mettre au concours le projet d’un canal Moselle-Saône. BM de Metz, 1342, f°717. [10]
François Varrentrap y publie notamment les écrits de La Tierce et de La
Beaumelle, tous deux francs-maçons, calvinistes, et hommes de culture. [11]
Bibliothèque Nationale, Cabinet des manuscrits, Fonds maçonnique, FM1
111, collection Chapelle, tome VI, fol. 116 ; fol. 125. A propos des réseaux
de correspondances maçonniques, voir Pierre-Yves Beaurepaire, « Au cœur
de l’expansion maçonnique du siècle des Lumières : la correspondance
fraternelle et ses réseaux », à paraître in Actes du 120e Congrès
des sociétés historiques et scientifiques, colloque interdisciplinaire
sur la correspondance, Aix-en-Provence 23-29 octobre 1995. [12]
C’est également un prisonnier de guerre, de Barailh, vénérable de la
loge La Parfaite Union, orient de Nya-Ålfsborg près de Göteborg en
1759, puis captif en Allemagne durant la guerre de Sept Ans, qui de retour
à Metz une fois la paix revenue, introduisit
en France le célèbre grade de Chevalier Kadosh. [13]
Cité par Ulrich Im Hof, L’Europe des Lumières, Paris, éditions
du Seuil, 1993, pp. 142-143. [14] Ludwig Hammermayer, « Die Benediktiner und die
Akademiebewegung im katholischen Deutschland 1720 bis 1770 », in Studien
und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige,
(1960), vol. 70, pp. 45-146. [15]
La loge maçonnique huppée La Candeur, orient de Paris, soumet alors
la même question à la réflexion des francs-maçons et des profanes éclairés. [16]
Notons d’ailleurs qu’un nombre non négligeable de négociants messins
alla s’établir dans les Iles, et participa activement, à l’instar de
François Pescaye, à la mise sur pied des structures de sociabilité
nouvelle, notamment maçonniques. [17]
D. Roche remarque à son sujet : « A Metz, si la Société des Philathènes
a une organisation plus souple que celle de l’académie et un recrutement
plus large, c’est surtout par une orientation plus philosophique et ses
travaux qu’elle rivalise avec la Société des Sciences dont plusieurs
membres participent à ses activités » [Daniel Roche, Le siècle
des Lumières en province..., op. cit., tome I, pp. 65-66]. [18]
« Tentation académique » qui explique également leur forte
implication dans les Musées. [19]
Nous préparons actuellement une étude sur le collège des Philalèthes de
Lille à partir du très riche fonds Gaboria de la Bibliothèque municipale
d’Alençon. [20]
Sur ce sujet, je me permets de renvoyer à ma thèse : L’Autre et le Frère,
L’Etranger et la Franc-maçonnerie en France au XVIIIe siècle,
sous la direction du professeur Alain Lottin, présentée devant l’Université
d’Artois le 10 janvier 1997, 4 volumes, 1068 p. [21]
BN, Cab. mss., FM, FM2 298, dossier Saint-Jean, ff
118-120. |